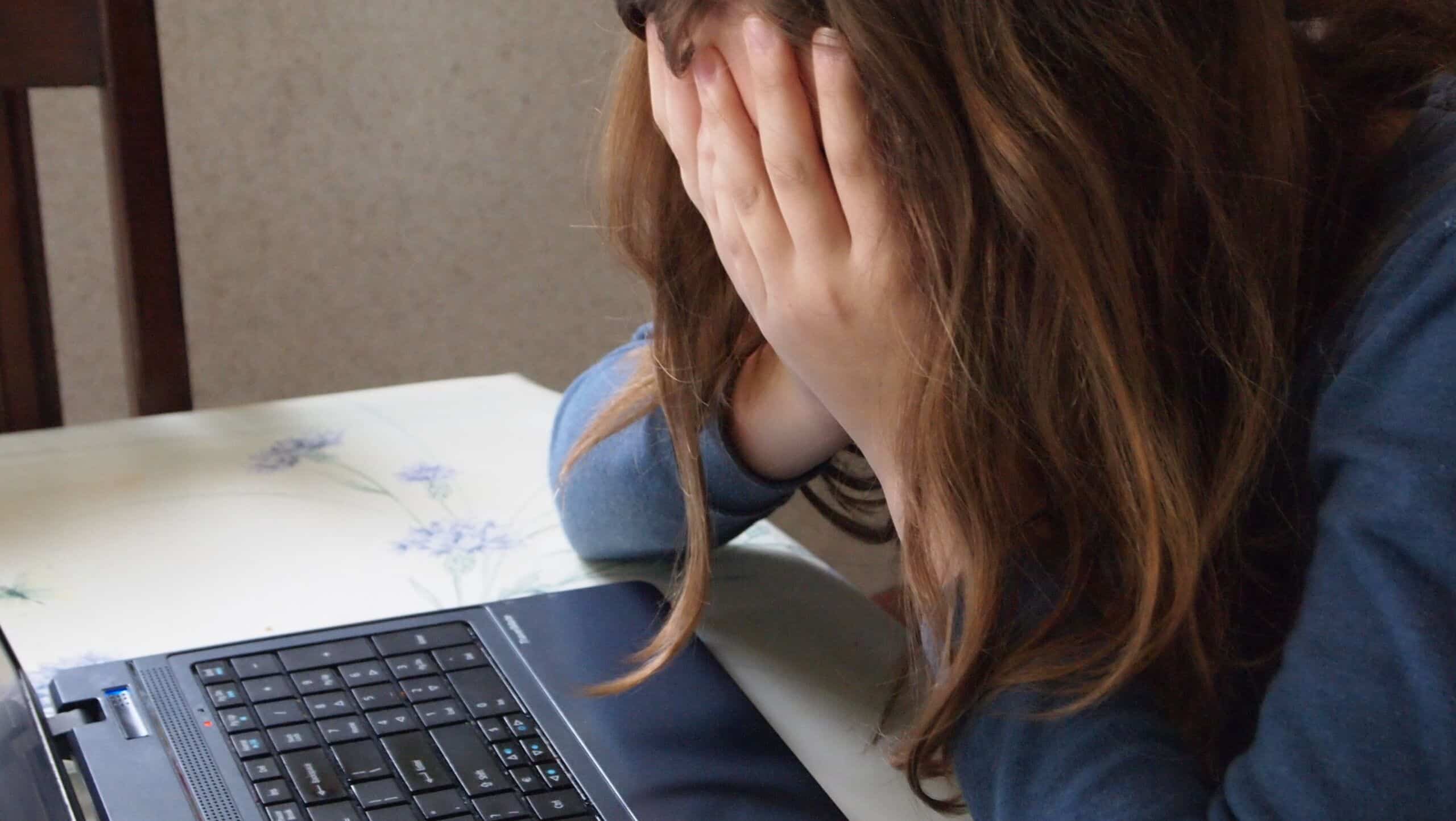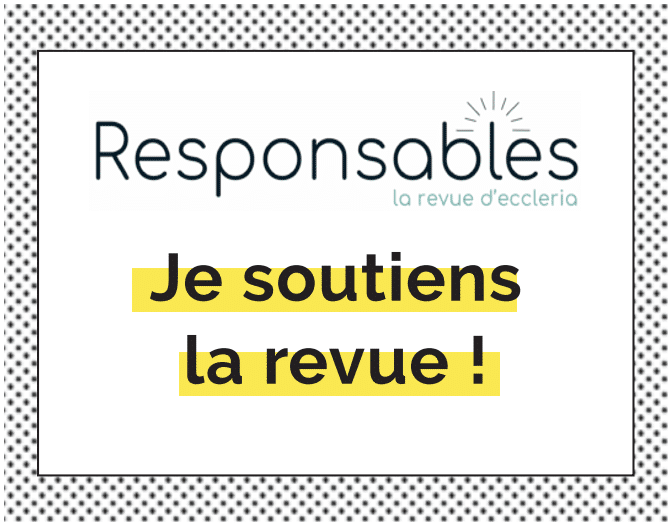Tristan Lormeau
Conseil en stratégie et transformation RH

Tristan Lormeau
Conseil en stratégie et transformation RH
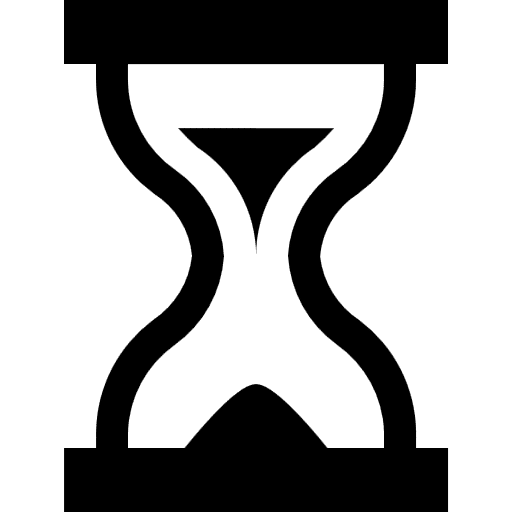
analyse
L’employeurabilité, une bonne nouvelle ?
Le couple employabilité-employeurabilité est-il devenu la clé de lecture d’un marché du travail au fonctionnement libéral assumé ou laisse-t-il subsister des angles morts qui nécessitent le recours à d’autres logiques ? Décryptage par Tristan Lormeau, conseiller en stratégie et transformation RH.
« Monsieur le Directeur, je vous informe que j’ai décidé de renouveler la période d’essai de votre entreprise ». C’est en ces termes qu’un nouvel embauché a écrit à son DRH, manifestant avec une pointe d’humour l’évolution des relations entre salariés et employeurs.
Après avoir accepté l’injonction de développer leur employabilité[1], formulée depuis les années 90 par les DRH et le marché du travail, les générations nouvelles adressent aux recruteurs une injonction d’« employeurabilité », sommés qu’ils sont d’offrir aux candidats des conditions d’emploi et de travail qui répondent à leurs attentes. Il est de bon ton, parmi les dirigeants qui peinent à recruter, de se lamenter sur la prise de distance de la génération Z par rapport au travail. Contrairement à certaines idées reçues, les Français, y compris les jeunes, sont très engagés par rapport à leur vie professionnelle[2] : « Le refus du travail n’est-il pas plutôt le refus d’un certain type de travail ou de management, ne reflétant pas tant un désengagement qu’une volonté d’engagement autrement ? »[3]
L’employeurabilité est la capacité d’une organisation à mobiliser des compétences
« L’employer-ability », vocable qui rend mieux le sens que sa malencontreuse traduction française d’« employeurabilité », a été évoquée pour la première fois en 2001 par Louise MORLEY, professeure d’éducation à l’université de Sussex[4]. Dès son origine, ce concept a été conçu en miroir avec l’employabilité, dans une optique d’équilibrage de la relation entre l’employeur et l’employé.
Le Robert définit l’employabilité comme « la capacité individuelle à acquérir et à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi. » L’employeurabilité, quant à elle, ne fait l’objet d’aucune définition. Je me risque à en donner une : « la capacité d’une organisation à mobiliser, de manière durable, les compétences dont elle a besoin pour mener à bien sa mission. »
Il est important de ne pas limiter l’employeurabilité à la “capacité des entreprises à recruter des salariés en CDI”. Outre les entreprises, les administrations publiques, les associations, les particuliers sont des employeurs concernés par le sujet. A la question du recrutement, il faut ajouter la capacité de rétention et de maintien du niveau d’engagement des personnes employées. Enfin, aux salariés en CDI, il faut ajouter les personnes travaillant sous d’autres statuts (freelancing, plateformes, intérim, CDD, fonction publique…).
Un marché du travail en transformation
Les évolutions technologiques, démographiques, sociétales sont souvent mises en avant pour expliquer la difficulté à pourvoir des emplois disponibles. Retenons comme points clés des transformations du marché du travail :
- Une évolution des aspirations des générations nouvelles par rapport au travail (autonomie, sens, rémunération, temps de travail, etc.) et, à l’autre extrémité de la pyramide des âges, le développement des séniors en tant que catégorie active.
- Une diversification progressive du statut juridique des emplois, avec l’érosion du modèle du CDI en entreprise au profit d’un recours accru aux CDD, à l’intérim ou au freelancing ; le développement accéléré du modèle des entrepreneurs individuels adossés à des plateformes digitales, coexistant avec les indépendants « traditionnels » que sont les artisans et les professions libérales ; le maintien d’un nombre important de « personnels à statut » dans le secteur public cotravaillant de plus en plus avec des salariés de droit privé, des intérimaires et des prestataires.
- La difficulté structurelle de certains secteurs à attirer des candidats : métiers du lien (crèches, Ephad), secteur hospitalier, restauration-hôtellerie, industrie, transport routier…
Ces évolutions interrogent l’employeurabilité des organisations non seulement vis-à-vis de jeunes diplômés, mais de publics, de secteurs, de générations et de territoires très variés, si bien que chaque employeur est aujourd’hui concerné.
Les conditions objectives de l’employeurabilité
Quelques conditions objectives « de marché » doivent être respectées pour être à même d’attirer et de retenir les salariés. Tout commence par la réputation digitale du secteur, de l’entreprise et de ses dirigeants. Le narratif autour du projet de l’organisation ou d’une marque est un levier puissant pour attirer des générations en quête de sens ou de reconnaissance. Et c’est sur internet que s’appuient bien souvent les critères de choix d’un métier, davantage que sur les professionnels de l’orientation pourtant beaucoup plus pertinents[5]. Il importe d’utiliser les bons canaux pour atteindre son public (réseaux sociaux, partenariats écoles, annonces, communication interne…).
Quels que soient les discours sur le sens au travail, la rémunération demeure souvent le premier domaine dans lequel s’expriment les attentes des salariés. J’y vois quelque chose de très sain : sauf exception, on travaille pour subvenir aux besoins de son foyer. L’employeurabilité ne peut faire l’impasse d’un positionnement correct par rapport au marché des rémunérations. Imaginer payer moins ses employés parce qu’on leur propose « un travail qui a du sens » est une illusion. Le sentiment d’équité, avec la nécessité d’une politique de rémunération explicable, est un aspect également important.
On rejoint une organisation pour son image ou celle de ses dirigeants ; on la quitte souvent en raison de mauvaises relations avec son manager direct. La qualité du management est un des facteurs de rétention les plus importants. Les enquêtes mettent en évidence une attente croissante de sécurité affective dans le travail reposant sur la qualité du management de proximité et l’intégration à un collectif de travail porteur d’une certaine camaraderie. Cette notion de « sécurité affective » semble aujourd’hui plus importante que celle de « sécurité de l’emploi » qui en reste une des dimensions.
Si le temps de travail est aujourd’hui un élément peu différenciant, la flexibilité d’organisation laissée au salarié l’est en revanche, et en particulier le télétravail. Ne pas proposer au moins un jour de télétravail par semaine est aujourd’hui un handicap. La mobilité géographique et la question des trajets est également déterminante, avec une préférence pour le changement d’employeur plutôt que le changement de territoire.
Enfin, les perspectives de carrière et de développement représentent un facteur positif, mais il faut en relativiser l’importance dans un marché où l’emploi à vie n’est plus une promesse centrale, ni pour les employeurs, ni pour la majorité des offreurs de travail.
Employeur, connais-toi toi-même !
Respecter les conditions objectives du marché est certes indispensable, mais ne suffit pas. Développer son employeurabilité suppose une prise de conscience de soi en tant qu’employeur, démarche active qui requiert un certain nombre d’étapes :
- Première étape, comprendre les besoins de compétences de son organisation et, en corollaire, identifier le public détenteur de ces compétences en veillant à ne pas s’interdire, sous l’effet de biais plus ou moins conscients, d’employer les compétences disponibles sur le marché (les deux biais les plus répandus étant la surqualification et le jeunisme).
- Deuxième étape, comprendre les besoins et les aspirations du public recherché, car toutes les populations n’ont pas les mêmes attentes par rapport au travail[6] .
- Troisième étape, formuler une promesse employeur qui soit réaliste, conscient des points forts et des points faibles de sa proposition d’emploi. Cette promesse est à la fois un récit sur l’organisation et son projet, l’emploi proposé et une description aussi claire que possible des conditions offertes. La clarté à ce stade est la meilleure garantie contre un effet déceptif potentiellement démobilisateur.
En conclusion, l’employeurabilité résulte d’une adéquation entre les besoins d’une organisation, son environnement, son public, et ce qu’elle est prête à offrir. Une ETI industrielle de province n’a ni les mêmes besoins, ni les mêmes moyens qu’une scale-up parisienne ; mais toutes les deux gagnent à être lucides sur leurs besoins, leur public et leur pouvoir d’attraction pour entrer dans un vrai dialogue avec leurs employés potentiels, fondement d’une coopération durable.
L’employeurabilité, une bonne nouvelle… pour les plus adaptables
La nécessité pour un employeur de développer cette capacité de dialogue avec les personnes qui détiennent les compétences qu’il recherche est en soi une bonne nouvelle. Cela revient à considérer la personne employée non comme une ressource, plus ou moins périssable, mais comme un sujet-acteur, partie d’un contrat dont les termes équilibrent les attentes dans la relation de travail. Cette double injonction employabilité-employeurabilité, responsabilisante pour les employés comme pour les employeurs, récompense les plus capables de s’adapter à un monde en transformation.
Mais il est clair que cette approche de la relation de travail ignore des difficultés objectives. De même que certaines personnes éloignées du marché du travail ne peuvent répondre à l’appel à développer leur employabilité, de même certains secteurs, en particulier le médico-social, peinent à recruter en raison des conditions actuelles : la meilleure approche de leurs dirigeants sur leur employeurabilité ne pourra compenser leur manque d’attractivité car ils ne remplissent pas les conditions objectives du marché, notamment en matière de salaire et de pénibilité.
La logique qui sous-tend le couple employabilité-employeurabilité, fondée sur la responsabilisation des acteurs privés, n’est pas suffisante. Elle doit être complétée, au niveau sociétal, par des politiques publiques spécifiques adressées à ces personnes et à ces secteurs. Quitte, pour en dégager les moyens financiers, à renvoyer plus clairement les autres acteurs du marché du travail à leur responsabilité propre.
[1] L’étude Kéa sur « les jeunes Français, la valeur du travail et l’entreprise » mentionne que « 64% des 16 ‑45 ans comptent d’abord sur eux-mêmes pour réussir leur vie professionnelle. » Enquête Opinion Way pour Kéa, novembre 2023
[2] L’étude Kéa révèle que 86% des Français âgés de 16 à 45 ans se déclarent engagés dans leur travail. Selon l’Institut Montaigne, près de 80% des jeunes actifs déclarent qu’ils continueraient à travailler même sans nécessité financière.
[3] « Aspirations et (dés-)engagements : les évolutions contemporaines du rapport au travail. Appel à contributions pour un dossier thématique de la revue Travail et Emploi », mai 2025
[4] « Perhaps we should develop the concept of employer-ability to balance out the power relations embedded in the employability discourse of recruitment and retention. » « Producing New Workers : quality, equality and employability in higher education » – Routledge — 2001
[5] Selon l’Institut Montaigne, les deux premières sources d’aide citées pour l’orientation professionnelle des jeunes sont la mère, puis internet.
[6] Une étude de l’Institut Montaigne consacrée aux aspirations des 16–30 ans vis-à-vis du travail conclut que les attentes en matière de qualité du travail vont croissant en fonction du niveau de diplôme, de la filière professionnelle ou généraliste, ou du genre, les jeunes femmes ayant plus d’attentes que leurs homologues masculins.