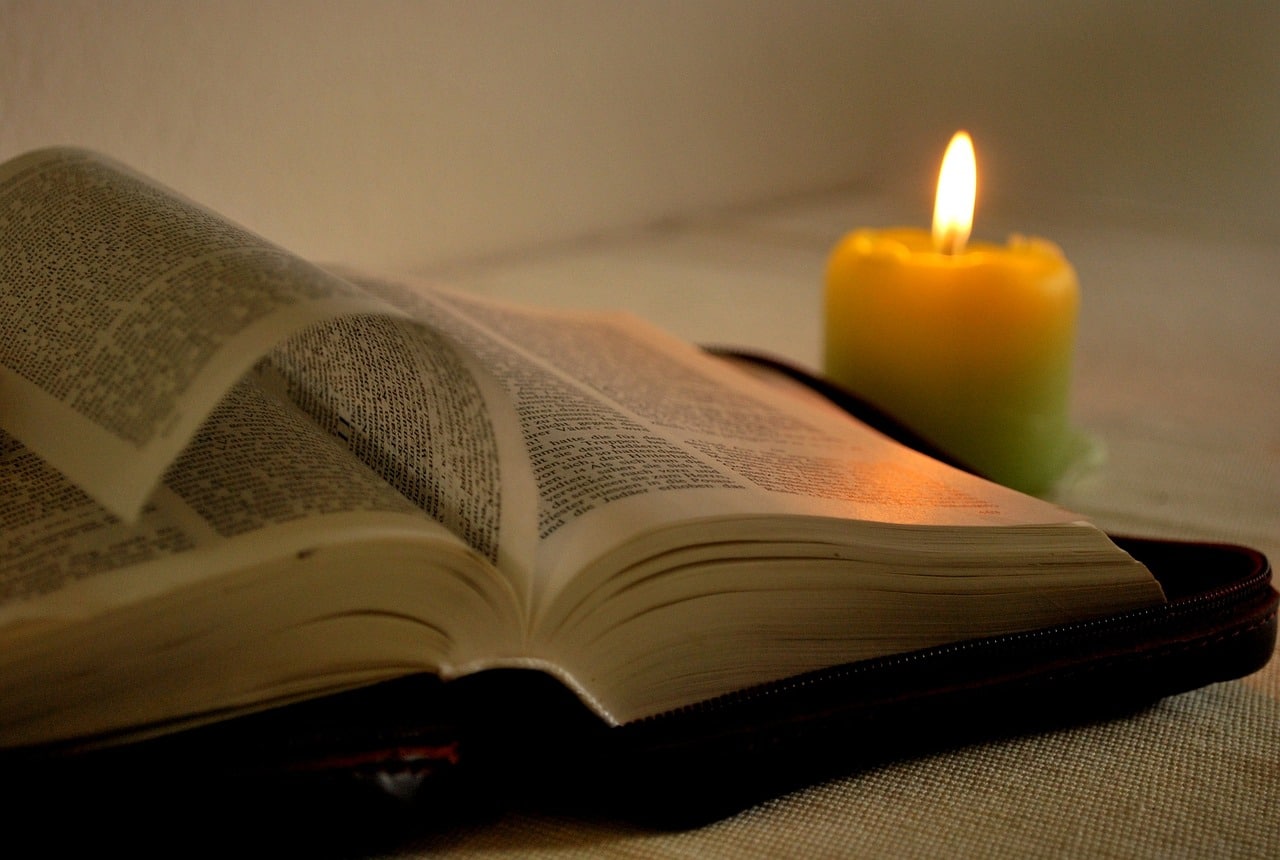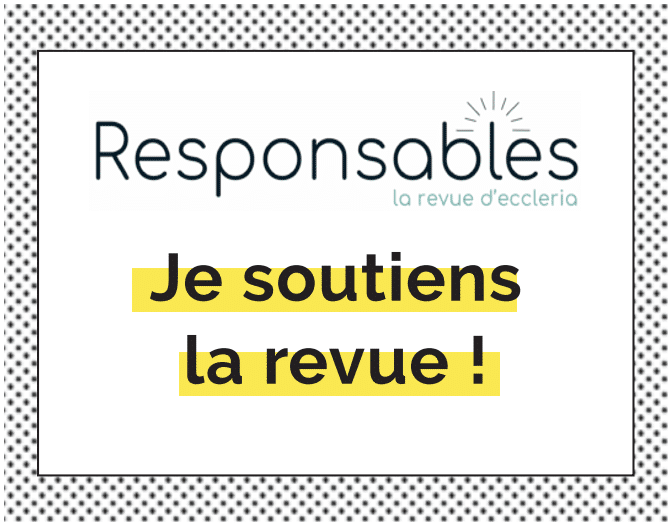Anne Doutriaux
Coordinatrice France du Mouvement Laudato Si’

Anne Doutriaux
Coordinatrice France du Mouvement Laudato Si’
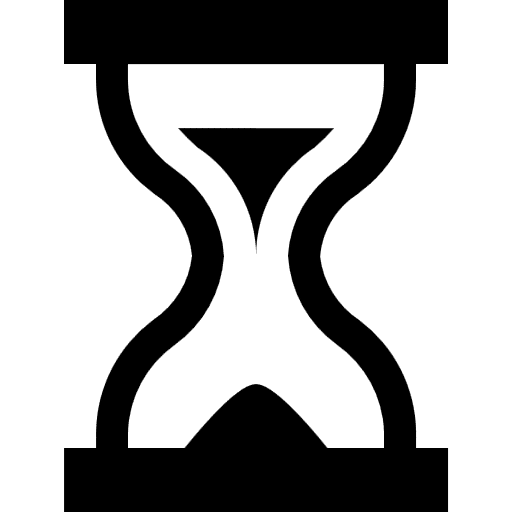
regard spirituel
Appelés à une conversion intégrale
Et si, en relisant l’encyclique, nous adoptions un nouveau regard sur la question écologique, un regard qui change tout ? “Cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne” nous rappelle le pape François.
Il y a dix ans, le 24 mai 2015, le Pape François signait un texte qui n’en finit pas de résonner aujourd’hui : Laudato Si’, pour la sauvegarde de notre maison commune. Il y formule le constat suivant : « Si nous prenons en compte la complexité de la crise écologique et ses multiples causes, nous devrons reconnaître que les solutions ne peuvent pas venir d’une manière unique d’interpréter et de transformer la réalité. (…) c’est un bien pour l’humanité et pour le monde que nous, les croyants, nous reconnaissions mieux les engagements écologiques qui jaillissent de nos convictions » (LS 63–64).
Laudato Si’ rejoint la réflexion d’autres confessions chrétiennes et nous donne des mots communs pour comprendre le lien entre foi et écologie.
Élargir le constat : « tout est lié »
La première chose que fait Laudato Si’, c’est de nous inviter à oser regarder. Il ne s’agit pas juste d’une crise climatique, d’une crise de la biodiversité, de la pollution ou du problème de l’eau — il s’agit aussi de la pauvreté, des inégalités, de la détérioration des conditions de vie, de l’individualisme, de relations sociales parfois superficielles. La “culture du déchet” produit des objets jetables et immédiatement remplacés par des neufs au lieu d’être réparés ; c’est la même logique qui conduit à considérer les êtres humains comme des ressources à remplacer lorsqu’ils ne sont plus suffisamment productifs.
Ainsi, Laudato Si’ nous explique : « Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-environnementale » (LS 139). Ce n’est qu’en regardant les choses dans leur ensemble, en sortant des fausses oppositions entre préservation de “l’environnement” et attention aux plus fragiles, que nous pourrons véritablement agir. D’ailleurs, Laudato Si’ ne nous parle pas d’environnement, qui serait comme un décor dans lequel l’être humain évoluerait, ni même de nature, mais de Création, nous rappelant que le monde est « un don qui surgit de la main ouverte du Père de tous » (LS 76).
Adopter ce nouveau regard change tout. Ce n’est pas toujours facile : Laudato Si’ nous parle « de prendre une douloureuse conscience, d’oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde » (LS 19). Cela peut paraître parfois complexe ou intimidant. Mais nous savons que nous ne sommes pas seuls dans cette entreprise : notre foi nous dit que Dieu est avec nous et notre expérience nous montre que de nombreuses personnes s’engagent sur ce chemin de conversion et d’action à nos côtés.
Comprendre les causes : la recherche de notre propre bénéfice
S’il n’y a qu’une seule crise complexe, il faut en chercher la cause. C’est sans doute l’un des apports essentiels de Laudato Si’ par rapport à d’autres textes sur la crise socio-écologique : comprendre ses manifestations comme des symptômes et creuser pour en comprendre la cause profonde, en la cherchant dans le cœur de l’homme. « S’il est vrai que ‘’les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands’’ [Benoît XVI], la crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure » (LS 217).
Cette cause, Laudato Si’ l’appelle « paradigme technocratique » ou « anthropocentrisme dévié ». Des mots complexes pour exprimer un état d’esprit que chacun peut reconnaître aujourd’hui autour de lui, et parfois en lui, consistant à voir toute chose sous le prisme de la ressource qu’elle nous apporte. C’est le cas, en premier lieu, de la Création : celle-ci n’aurait de valeur que si elle est utilisable à notre bénéfice, cette logique s’appliquant tant à la Terre qu’aux hommes.
Décider par soi-même ce qui est bien et ce qui est mal en fonction de ce qui nous arrange. Faire de l’être humain un dominateur, qui pense que tout sera résolu par la technique, sans accepter aucune limite. Lorsque j’explique ce paradigme à des personnes non croyantes qui sont engagées dans la lutte environnementale, elles ont souvent la même réaction : « oui, c’est exactement ça ! ».
Appelés à une nouvelle manière de vivre, guidés par la foi
De son côté, la Bible nous montre que nous sommes appelés à prendre soin du monde comme d’un jardin que Dieu nous a confié pour le cultiver et le garder (Gn 2, 15), à l’image du Christ qui se fait serviteur par le geste du lavement des pieds. C’est toute la Bible qui peut nous éclairer, et, en premier lieu, l’image de Jésus, dont Laudate Deum, autre texte majeur, nous dit : « Comment ne pas admirer cette tendresse de Jésus pour tous les êtres qui nous accompagnent sur notre route ? » (LD 1).
Lire aussi : le dossier de Responsables sur Laudate Deum
Nous sommes donc appelés à une conversion écologique, pour reprendre les mots du pape Jean-Paul II. Ne nous méprenons pas sur ces mots : ce n’est pas d’une conversion à l’écologie dont il s’agit (d’ailleurs, de quelle écologie parlerait-on exactement ?) mais d’une conversion au Christ, d’une « conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure » (LS 217).
Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part essentielle d’une existence vertueuse ; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire dans l’expérience chrétienne
Concrètement, l’importance de la contemplation
Tout d’abord, quelque chose se joue dans le regard, comme dit plus haut, et dans notre vie de foi. Le Pape François écrivait que « le meilleur antidote contre cet usage impropre de notre maison commune est la contemplation ». Nous sommes pris dans des rythmes de vie insensés, où les activités s’accumulent dans une course au toujours plus, sous-tendue parfois de recherche de performance.
La première étape, et peut-être l’une des plus difficiles, c’est donc de s’arrêter. Pas forcément longtemps. Pas avec des méthodes complexes à suivre. Regarder la Création autour de nous comme un livre écrit par Dieu où il nous parle, nous laisser toucher parce ce qui nous entoure, ouvrir notre cœur. Retrouver une relation avec la Création.
Beaucoup de jeunes qui ont souffert d’écoanxiété expriment combien cette relation leur fait du bien. Une relation qui ne s’oppose jamais à la relation avec les autres ni avec Dieu, mais recrée une harmonie en nous et autour de nous.
Cette contemplation ne doit jamais être séparée ou opposée à l’action
Quel sens aurait notre conversion si elle ne se traduisait pas par des actes concrets dans notre vie ? Ces actes peuvent être les fameux éco-gestes bien connus : faire le tri des déchets, réduire sa consommation de viande, acheter des produits locaux, privilégier les transports en commun ou les transports doux quand cela est possible, etc.
Pour nous, chrétiens, il ne s’agit toutefois pas simplement de suivre des injonctions pour respecter les limites planétaires, même si c’est nécessaire. Le sens donné à ce geste, l’intention, sont essentiels. Sortir de la surconsommation, c’est aussi se poser la question de ce qui est vraiment important et qui, le plus souvent, n’est pas un produit de consommation : l’amitié, le partage, une promenade en forêt, un jeu fait en famille, etc. Tous ces gestes faits avec amour créent une nouvelle culture (LD 71) et constituent un témoignage, dont nous n’avons pas forcément conscience et dont nous découvrons parfois la force après coup. « La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout le contraire. (…) On peut vivre intensément avec peu » (LS 223).
Nous sommes également appelés à nous mobiliser collectivement et à crier comme le faisaient les prophètes. Interpeller les dirigeants en amont des sommets sur le climat, rejoindre des mobilisations religieuses ou citoyennes comme lors du Temps pour la Création, appeler les institutions à refuser de soutenir les nouveaux projets d’extraction fossile par leurs investissements, sensibiliser autour de soi (par exemple par des projections de films comme La Lettre). Le Mouvement Laudato Si’, avec d’autres, propose ce type de mobilisation. Cette dimension est d’ailleurs au cœur de la pensée sociale chrétienne, dont Laudato Si’ fait partie, et qui nous invite à agir au sein de la société, scrutant les signes des temps pour apporter les réponses dont le monde a besoin, selon les mots de notre pape Léon XIV.
La dimension de l’espérance
Comment terminer sans parler de l’espérance ? La crise socio-écologique nous met face à des problèmes qui semblent parfois désespérés, insurmontables. « Pensez-vous que le monde va s’effondrer ? » me demandait un jour quelqu’un dans ma paroisse. Les mots de Saint Pierre me sont tout de suite revenus en mémoire : « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous » (1P3, 15).
Face aux résultats en demi-teinte des négociations internationales des COP sur le climat, aux reculs de programmes qui soutiennent la transition, à la montée de discours climatosceptiques, la tentation est grande de baisser les bras. En tant que chrétiens, notre rôle le plus important est peut-être d’être la petite voix de l’espérance qui répète avec obstination qu’un autre monde est possible.
On a fait beaucoup de choses, ça n’a pas rendu les gens heureux. On va faire les choses différemment, et ça va rendre les gens heureux
« Nous savons que les choses peuvent changer » (LS 13) écrit le Pape François dans Laudato Si’. Aujourd’hui, nous sommes sans doute appelés à répéter avec obstination que les inégalités, la logique du système économique, l’augmentation sans fin des émissions de gaz à effet de serre et le dépassement des limites planétaires ne sont pas inéluctables. D’autres voies sont possibles. Le dialogue est possible.
Ces dernières années, un grand nombre de penseurs, de politiciens, de scientifiques se sont exprimés sur ces sujets. Les chrétiens ont aussi quelque chose à dire, à vivre face aux enjeux de la crise écologique. Une personne du Quart Monde le résumait ainsi lors d’une rencontre organisée par ATD : « on a fait beaucoup de choses, ça n’a pas rendu les gens heureux. Il faut expliquer qu’on va faire les choses différemment, et ça va rendre les gens heureux ». Une véritable bonne nouvelle à porter dans notre monde.