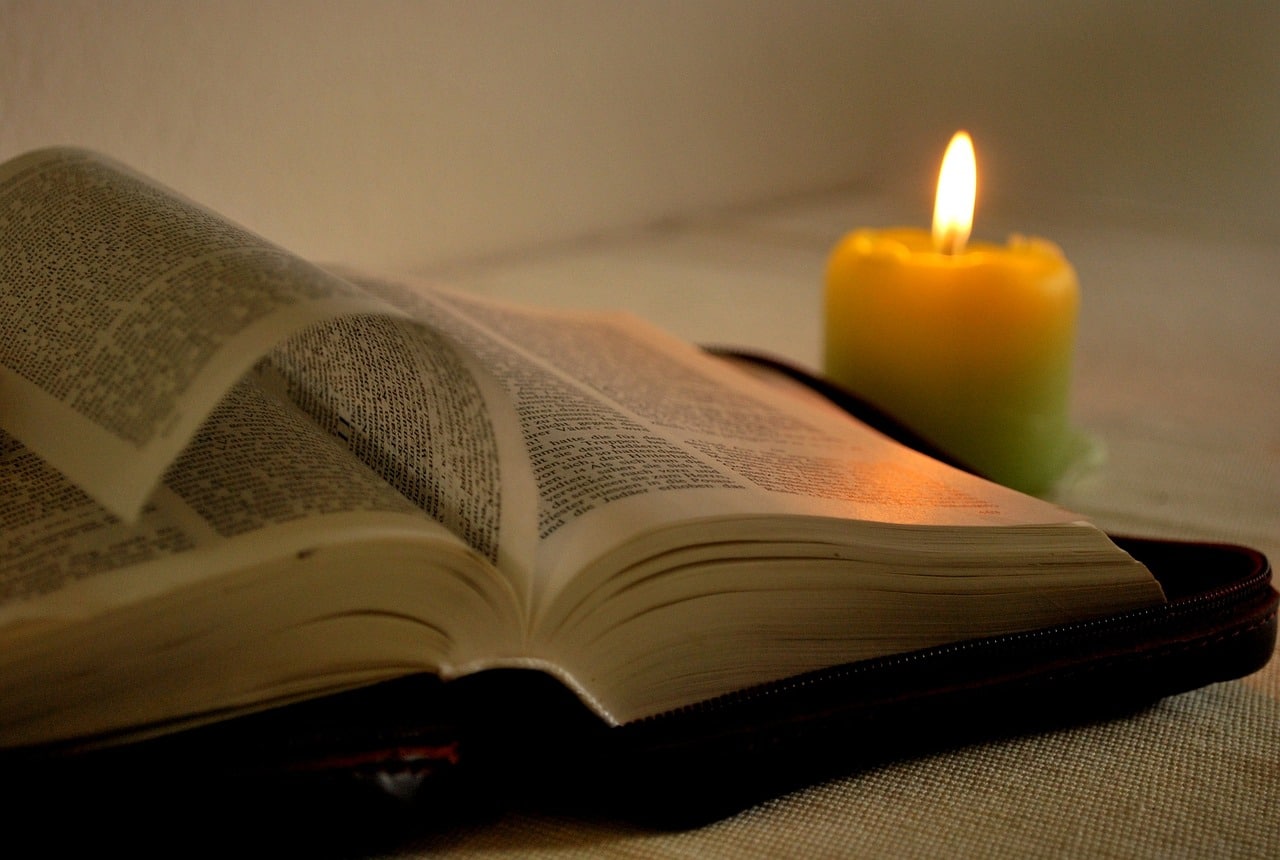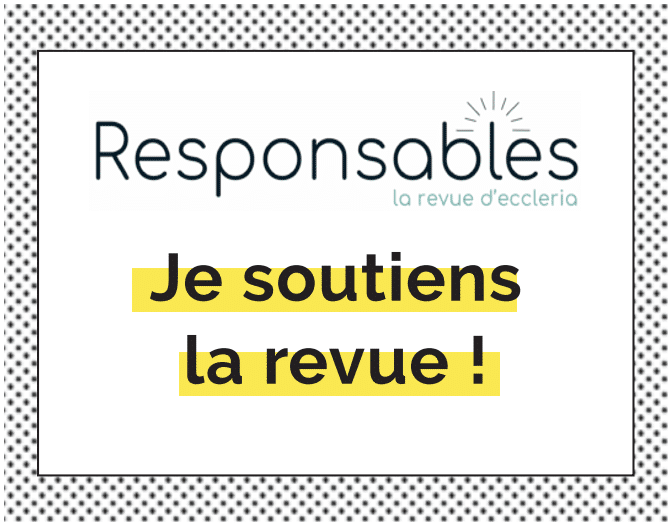Frédéric Rognon
Professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de Strasbourg

Frédéric Rognon
Professeur de philosophie à la faculté de théologie protestante de Strasbourg
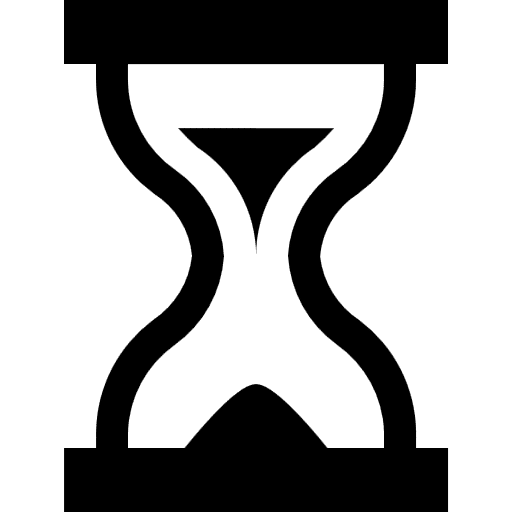
point de vue
Regard protestant sur Laudato Si’
Le professeur de philosophie Frédéric Rognon nous partage son analyse sur l’héritage de l’encyclique au sein de l’Eglise protestante, présentée en juin 2025 lors d’une soirée débat aux Facultés Loyola.
Laudato Si’ est à l’évidence, de tous les textes du magistère catholique, celui qui a reçu la meilleure réception dans le protestantisme. C’est même sans doute le cas au-delà du monde chrétien, et dans le monde entier. Il faut dire que le pape François était aimé de beaucoup de protestants, pour son ouverture et ses engagements.
Soyons cependant honnêtes : Laudato Si’ n’a pas fait l’unanimité chez les protestants. Le protestantisme est divers par nature, la pluralité fait partie de son ADN et l’unanimité est un mot qui n’y existe pas. Par conséquent, il y a toujours des protestants qui sont indifférents, voire sceptiques, envers tout ce qui vient de Rome.
Un accueil favorable de Laudato Si’
Mais globalement, Laudato Si’ a été accueillie par la plupart des protestants avec beaucoup de bienveillance. Pourquoi cette bienveillance ? Cela tient, à mon sens, à deux principales raisons. Tout d’abord, face à l’immensité des défis qui concernent l’avenir du vivant sur notre planète, les polémiques doctrinales sont mises au second plan, l’essentiel est d’être tous ensemble, avec nos différences, et de nous retrousser les manches.
Le deuxième facteur de cette bienveillance tient au lien très étroit que le pape François fait entre écologie et justice sociale (ou pour le dire en termes familiers, entre « la fin du monde » et « la fin du mois »). Le courant théologique du christianisme social, qui est l’un des principaux courants au sein du protestantisme, ne pouvait qu’être sensible à cette approche.
Lire aussi : Le défi d’un changement économique systémique
D’où le succès du concept d’écologie intégrale. Même si les protestants parleront plutôt de « sauvegarde de la Création », il n’empêche que Martin Kopp, écothéologien protestant de référence en francophonie, a intitulé son livre : Vers une écologie intégrale. Ce rapprochement du vocabulaire est un véritable signe d’un travail mené en commun pour construire un langage commun.
Un éveil tardif
En réalité, davantage que d’une influence de Laudato Si’ sur le monde protestant, il faudrait parler d’une rencontre, ou plus précisément d’une synergie. L’encyclique est en effet arrivée au moment même où les protestants français s’éveillaient à l’écologie. Il faut dire que le protestantisme français revenait de loin.
En effet, contrairement à l’orthodoxie, le protestantisme français n’a pas joué de rôle prophétique en matière d’écologie. Il ne s’est ouvert à l’écologie que tardivement, lorsque l’opinion publique s’y est intéressée, alors même qu’il a été précurseur dans d’autres domaines : promotion de la femme, laïcité ouverte, solidarité envers les persécutés, etc. Cela est d’autant plus paradoxal que le protestantisme français bénéficiait de conditions particulièrement favorables : des figures éminentes ont joué un rôle de lanceurs d’alerte (Charles Gide, Albert Schweitzer, Wilfred Monod, Théodore Monod, Jacques Ellul, Gérard Siegwalt), mais n’ont pas été écoutés par leurs Églises. Et le scoutisme unioniste, fondé sur la connaissance et le respect de la nature, a marqué des générations de protestants sans influencer les institutions ecclésiales.
En dehors de l’Alsace et de Moselle, la prise de conscience des problématiques de dégradation de la nature a été très tardive. En 1989, le protestantisme français a traîné les pieds lors du grand rassemblement de Bâle organisé par le conseil œcuménique des Églises (COE) autour du processus conciliaire « Justice, Paix, Sauvegarde de la Création ». Plusieurs de ses responsables ont même écrit un ouvrage polémique contre l’initiative du COE sous le titre : L’agitation et le rire, affirmant que l’écologie était une idéologie à la mode dont on ne parlerait plus dans dix ans. Et pendant un quart de siècle, jusqu’en 2014, l’Église réformée de France n’a mis l’écologie à l’agenda d’aucun de ses synodes, d’aucune de ses formations de pasteurs et de laïcs, d’aucun de ses colloques. Or, ces années-là ont été cruciales en qui concerne la dévastation de la planète.
Le grand tournant date de 2014
Cette année-là, soit un an avant Laudato Si’, la commission « Église et société » de la Fédération protestante de France et le réseau « Bible et Création » de l’Église protestante unie de France organisent un grand colloque intitulé Terre créée, terre abîmée, terre promise. C’est un grand succès, et le début d’une profonde prise de conscience. De sorte que, lorsque paraît Laudato Si’, le terrain est préparé : la synergie va pouvoir jouer pour l’engagement des chrétiens, réunis par-delà leur diversité ecclésiale, pour la réussite de la COP 21 à la fin de l’année 2015. Ensuite, les protestants vont essayer de rattraper le temps perdu.
En 2016, dès la fondation d’« Église verte », les protestants vont s’y investir, au point qu’aujourd’hui un tiers des Églises locales qui ont le label Église verte sont protestantes (88 des 380 paroisses de l’Église protestante unie de France). En 2017, la Fédération protestante de France crée une commission « Écologie et Justice climatique ». En 2019, l’Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine crée un poste de chargé de mission pour la justice climatique.
Repentance et conversion
Mais l’événement décisif est le synode de l’Église protestante unie de France d’octobre 2021, consacré à la thématique Écologie : quelles conversions ? Les textes adoptés lors du synode commencent par faire acte de repentance pour les silences et compromissions des Églises dans les dévastations de la planète. Ce n’est pas tous les jours qu’une Église se repent, non pas pour ce qu’ont fait nos ancêtres du XVIe siècle mais pour ce que nous avons fait ces dernières décennies.
Dans une belle synergie avec l’Église catholique, le protestantisme français cherche désormais résolument à “racheter le temps”
Puis l’Église protestante unie de France prend un certain nombre de décisions. Elle transfère ses fonds dans une banque transparente sur ses placements, en cohérence avec ses convictions pour l’avenir de la planète ; cette mesure, que peu d’autres Églises ont prise, n’est pas que symbolique. Elle institue par ailleurs des formations spécifiques pour les futurs pasteurs et les laïcs. Elle invite également toutes les Églises locales à travailler leur liturgie, leur prédication, leur catéchèse, leur gestion énergétique, leurs mobilités, leurs repas de paroisse, etc. et les exhorte à s’engager dans l’obtention du label « Église verte ». Enfin, elle décide d’accorder un temps spécifique lors de chaque synode annuel pour évaluer la réalisation des engagements pris d’une année sur l’autre.
Ainsi, dans une belle synergie avec l’Église catholique, le protestantisme français cherche désormais résolument, comme le dit l’apôtre Paul, à « racheter le temps » (Ep 5, 16).