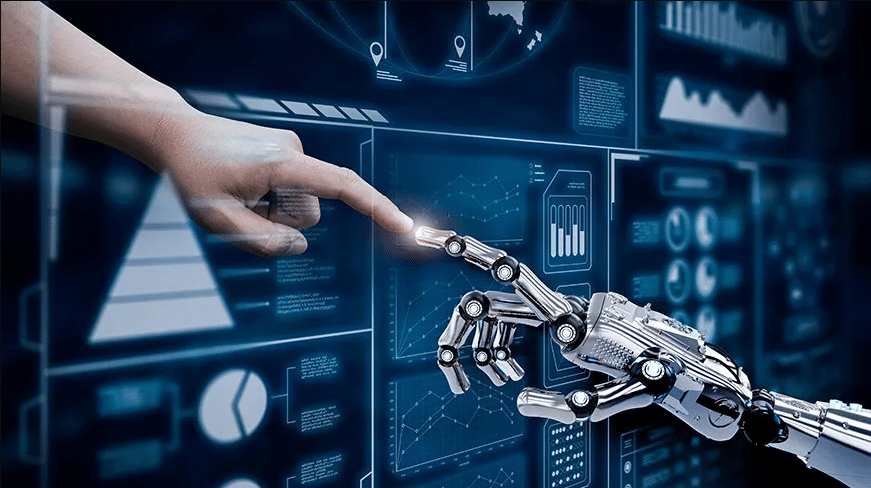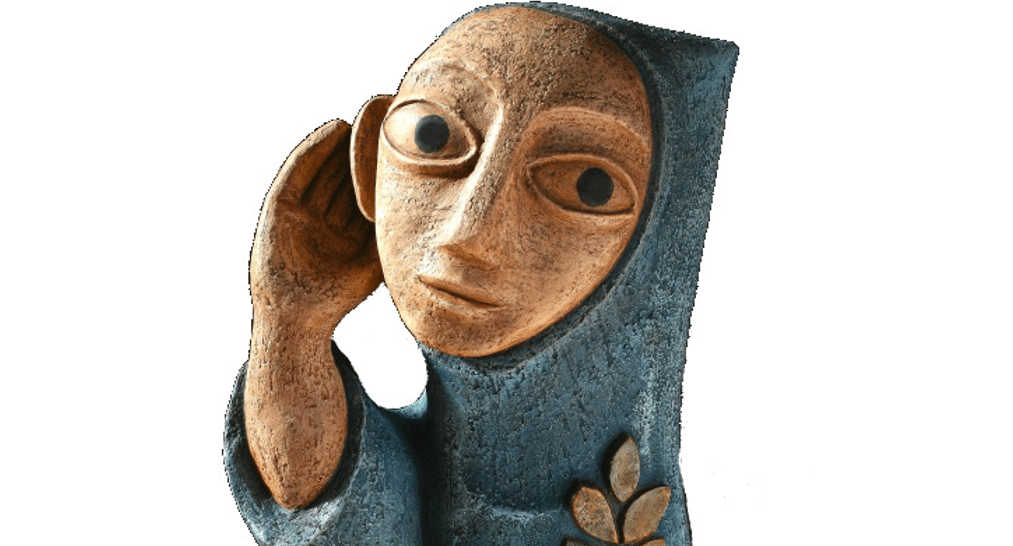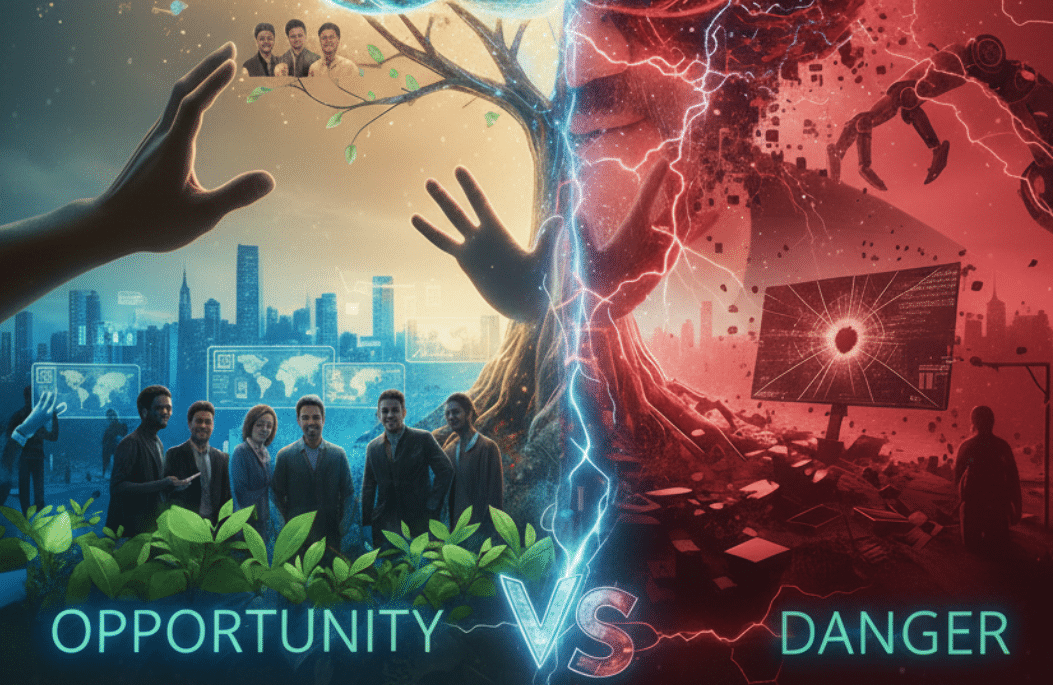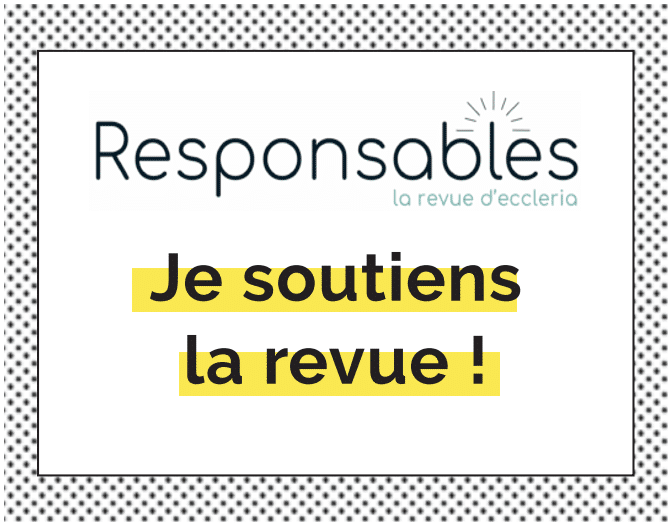Dominique Greiner
Dominique Greiner, théologien moraliste et membre du directoire du groupe de presse et d’édition Bayard

Dominique Greiner
Dominique Greiner, théologien moraliste et membre du directoire du groupe de presse et d’édition Bayard
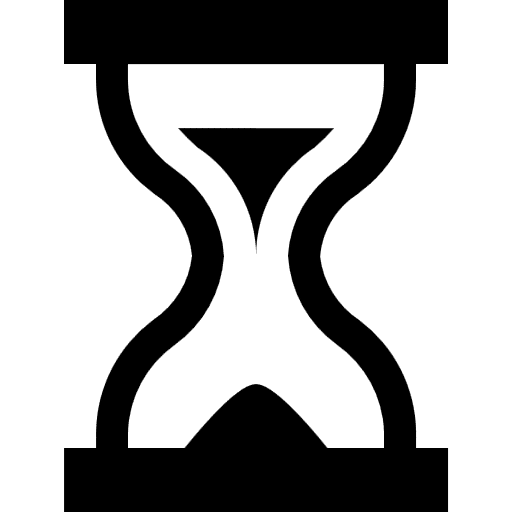
regard spirituel
L’IA sous le regard d’un théologien
Les questions éthiques soulevées par l’IA appellent à un investissement théologique, y compris sur le plan fondamental, ainsi qu’à un dialogue renouvelé avec le monde scientifique.
Cet article est un court extrait d’un état de la littérature rédigé par Dominique Greiner en novembre 2023 pour un groupe de travail de la Conférence des évêques de France sur l’IA. Le texte intégral est disponible ici.
Le dialogue foi-science trouve [dans l’IA] un nouveau terreau (…) Par exemple, Oviedo invite à explorer davantage les façons dont la théologie peut communiquer avec la technologie de l’IA, pour que la théologie repense et reconfirme sa pertinence dans le monde moderne. Plutôt qu’une « herméneutique du soupçon » théologique à l’égard des réalisations de l’IA, il souligne la nécessité d’un modèle de collaboration entre la recherche technologique et la théologie : une approche religieuse peut interagir avec les progrès de l’IA pour améliorer la qualité de la vie humaine, puisque les deux se réfèrent à des aspects spécifiques de la vie humaine.
La perspective essentiellement critique sur le transhumanisme cède ainsi la place à des interrogations fondamentales sur nos grandes catégories anthropologiques. La théologie se découvre concernée au premier chef, et pas seulement sur un plan moral. La réflexion est aujourd’hui relayée par une réflexion plus dogmatique. Comme l’écrit Patrick Goujon dans l’éditorial du numéro des RSR [Recherches de Science Religieuse d’octobre 2023] : « ce qui de l’humain passe à l’intelligence artificielle interroge en retour l’identité humaine. Que nous reste-t-il en propre si la machine à ce point nous ressemble ? Qu’est-ce qui nous fait humains si nous n’exerçons plus la maîtrise sur ce que nous avons produit, si la parole n’est plus ce qui nous caractérise et ce que l’on adresse au monde ?» (p. 595)
Lire aussi : L’intelligence artificielle éclaire la décision, elle ne decide pas
Après ce très rapide cadrage, je voudrais sonder de manières plus précises quelques-uns des ouvrages ou articles récents consacrés à l’IA d’un point de vue théologique.
La place des machines dans le plan de salut de Dieu
La question qui retient l’attention de Jean-Marc Moschetta est de savoir si les objets techniques, conçus par l’homme grâce à son génie propre, sont également concernés par le salut en Christ (ce qui amène aussi à réfléchir sur le rapport de l’homme aux artefacts)[1].
L’auteur, s’appuyant sur le pape François, estime nécessaire de sortir d’un anthropocentrisme où « l’homme reste le centre et l’objectif principal du plan de salut de Dieu » : « Or, il faut à présent renouer avec la perspective cosmique d’un salut universel ouverte par saint Paul et le christianisme ancien, et encore présente dans la tradition chrétienne orientale. Cette ouverture cosmique du salut ne saurait s’arrêter aux seuls objets naturels, mais concerne aussi la totalité de ce qui a été créé par Dieu, tout en étant produit par l’homme : machines, nombres, concertos, poèmes. L’essor des systèmes d’intelligence artificielle, en relativisant la place de l’homme au sommet de la vie intellectuelle, réinterroge plus particulièrement le statut des machines et invite la théologie chrétienne à se prononcer sur leur avenir dans la perspective de ce que nous proposons d’appeler la ‘résurrection intégrale’ » (p. 15–16).
L’auteur commence par une réflexion nourrie bibliquement sur le concept d’intelligence en montrant qu’elle est « au cœur du projet de Dieu ». Il montre la place centrale qu’elle occupe dans la pensée chrétienne tout en soulignant que « l’intelligence n’est cependant pas, à elle seule, une garantie de progrès vers le bien (…). Et avec Jean méditant sur le mystère de l’amour, nous voyons que l’intelligence n’est pas le dernier mot du mystère de Dieu, mais ce que c’est l’amour qui le caractérise le plus authentiquement » (p. 34). L’auteur en tire la conclusion que cela « nous permet de tenir à distance toute méfiance de principe vis-à-vis des systèmes d’intelligence artificielle (…). Reste à savoir si cela permet à l’homme de fabriquer à son tour des systèmes intelligents » (p. 36).
Sa réflexion se poursuit en montrant que l’intelligence n’est pas un attribut spécifiquement humain. Il existe en effet une forme d’intelligence chez les animaux et aussi chez les machines, et toutes ces formes d’intelligence, argue l’auteur, ont en commun de se construire, c’est-à-dire « d’apprendre le monde en l’expérimentant » (p. 48) : « L’intelligence humaine est un concept foncièrement ‘historique’, qui passe par une construction – et est donc a priori transposable à la machine -, et non une qualité propre à l’humanité comme peut l’être la station debout ou encore la morphologie de la main. (…). En définitive, si l’intelligence est affaire de construction, c’est bien qu’elle peut être fabriquée, élaborée, suscitée, autrement qu’en laissant faire le cours naturel de l’évolution des espèces biologiques. Cette observation ouvre donc la possibilité de fabriquer des systèmes d’intelligence artificielle, et permet de considérer cette possibilité non comme une infraction aux lois de la nature, mais comme un prolongement de ce que la nature a permis. » (p. 51–52).
Le sens de l’activité créatrice de l’homme
Moschetta donne ainsi une légitimité à la recherche sur l’IA. Il poursuit sa réflexion en s’interrogeant sur le sens de l’activité créatrice de l’homme. En quoi peut-il être dit co-créateur ? Est-il simplement un gérant de ce qui existe déjà ou est-il en capacité de faire surgir du neuf, du nouveau ? pour l’auteur, il faut se dégager d’une conception étroite de la « participation de l’homme à l’œuvre créatrice de Dieu », qui s’en tient à « une gérance prudente du monde et de l’allégeance permanente au pouvoir de Dieu » (p. 69). Pourtant dans le domaine artistique, l’homme est capable de faire surgir du neuf : « on peut se demander si Mozart, lorsqu’il composait le Concerto pour clarinette, ou Michel-Ange, lorsqu’il peignait le plafond de la chapelle Sixtine, exerçaient simplement une ‘intendance créative’ ou bien s’ils faisaient éclore une réalité radicalement nouvelle, irréductible à la simple mise en ordre des éléments naturels mis à leur disposition (…) » (p. 69).
Et pourquoi ne pourrait-il pas en être de même dans l’ordre technique comme dans l’ordre artistique ? Si le progrès technique est un « don de Dieu » comme le magistère l’a affirmé plus d’une fois, alors l’homme peut le remettre avec confiance dans les mains de Dieu : « Placer ainsi les ‘machines et les nombres’ au pied de Jésus, telles des offrandes faites en réponse à l’invitation divine à coopérer à l’œuvre créatrice de Dieu, suggère que l’homme adopte vis-à-vis de la technologie, et en particulier des machines intelligentes, la même attitude sacerdotale que celle qu’il doit avoir vis-à-vis des autres êtres vivants. Les systèmes d’intelligence artificielle ne doivent pas être idolâtrés, en prenant la place de Dieu, mais ils peuvent être offerts à Dieu, pour être purifiés, ‘humanisés’ avec le désir que ces réalisations techniques contribueront à la transformation définitive et totale du monde voulue par Dieu. » (p. 74–75)
La destinée des productions de l’homme
On l’aura compris, le regard positif sur les machines et l’IA n’est pas sans poser des limites. L’auteur peut alors faire un pas en avant dans la réflexion pour s’interroger sur la place et la destinée des productions de l’homme – artistiques et technologiques – dans le plan de salut de Dieu. La question semble provocante – on s’interroge bien depuis peu sur la place des animaux dans ce plan. La question de ce qu’il advient des artefacts est donc tout à fait légitime. L’auteur écrit : « Le décret Ad Gentes du concile Vatican II affirme que l’Église est appelée ‘à sauver et à renouveler chaque créature, afin que toutes les choses soient récapitulées dans le Christ et que tous les hommes constituent avec lui une seule famille et un seul peuple’. Par ‘toutes les choses’ ou ‘chaque créature’, il faut donc entendre la totalité de ce qui a été créé – créatures spirituelles et matérielles -, donc « également les objets, des plus remarquables aux plus insignifiants, tout ce qui compose la réalité. Tout. » (p. 118)
En d’autres termes, si le Christ est véritablement le but de cet univers, la christologie doit faire place à une forme de salut pour les machines et pour la dimension technologique de l’homme. L’auteur avance même l’expression « mystique de la machine ».
***
[1] Jean-Marc Moschetta, « Penser le corps augmenté à partir du concept de « corps spirituel », Revue d’éthique et de théologie morale, vol. 302, no. 2, 2019, pp. 59–72 ; « L’intelligence artificielle entre science et théologie », Revue d’éthique et de théologie morale, vol. 307, no. 3, 2020, pp. 81–92.