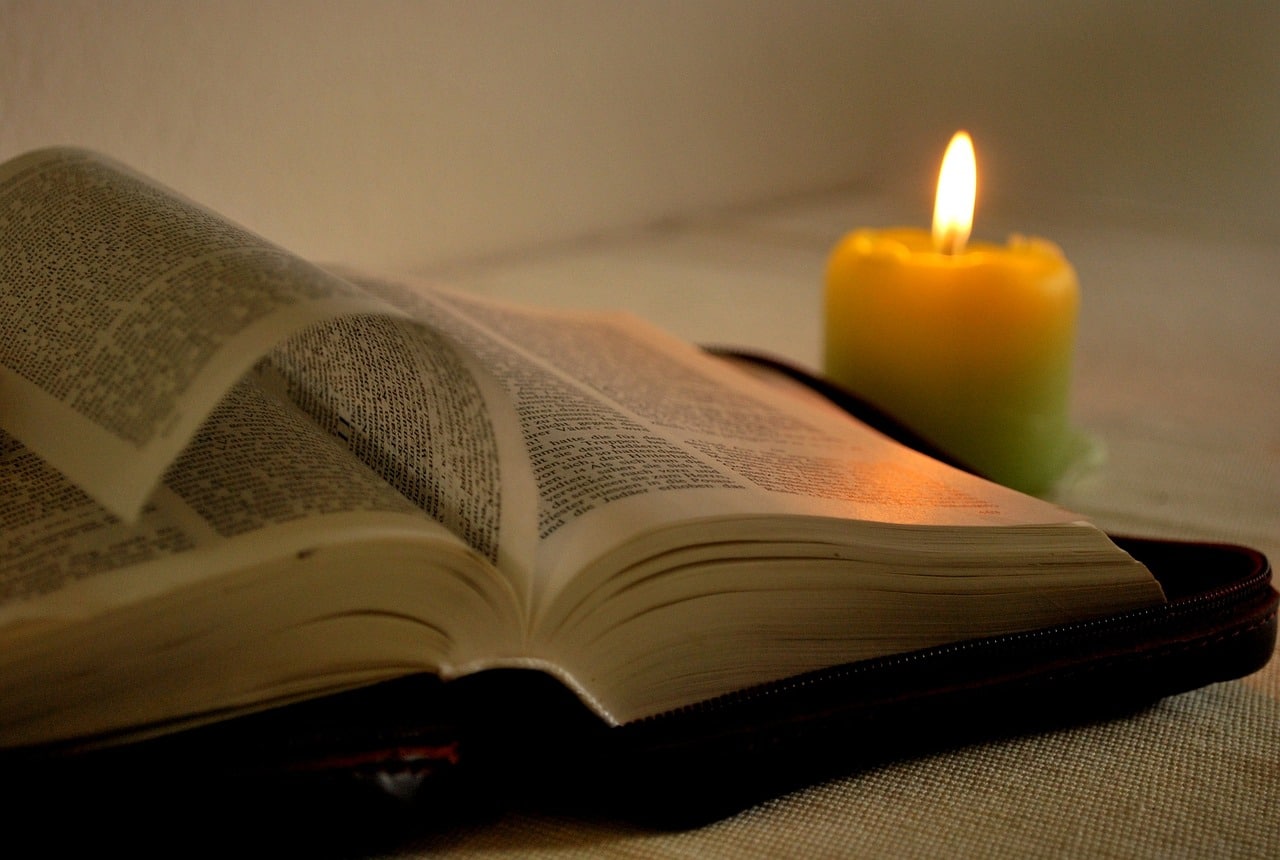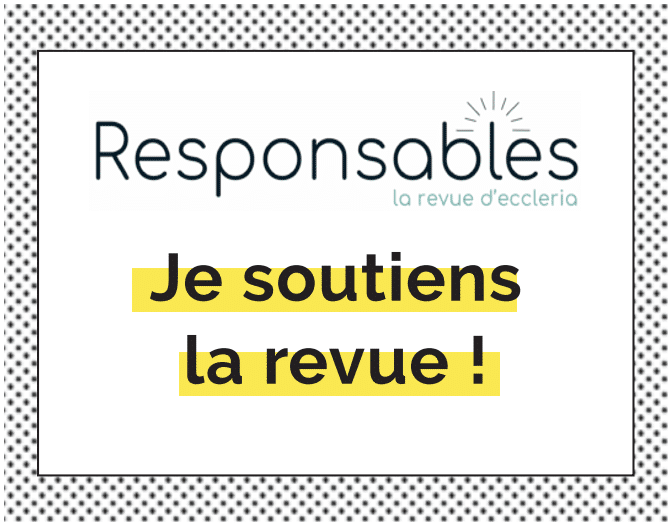Mireille Lévèque
Comité de rédaction, spécialiste des questions écologiques

Mireille Lévèque
Comité de rédaction, spécialiste des questions écologiques
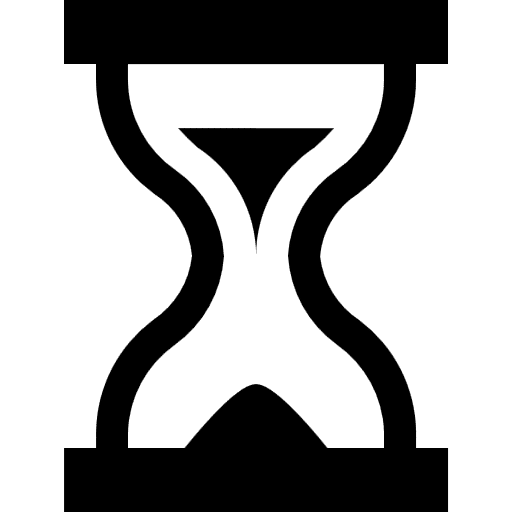
analyse
A la source d’un nouveau dialogue interreligieux
La parution en juin 2015 de l’encyclique Laudato Si’ a marqué un tournant décisif dans le discours écologique mondial, suscitant un écho considérable bien au-delà des cercles chrétiens.
Sous-titrée Sur la sauvegarde de la maison commune, l’encyclique s’adresse à « chaque personne qui habite cette planète », appelant à une « conversion écologique » fondée sur une vision intégrale de l’être humain et de la création. Au-delà de son impact immédiat dans la sphère politique internationale, elle a permis de sensibiliser un nouveau public à l’importance de l’écologie dans la construction d’un monde plus juste et durable.
Ce texte a redonné de la légitimité à une parole religieuse dans les débats publics, là où elle était parfois marginalisée, en montrant que la foi peut nourrir une réflexion éthique profonde sur les enjeux contemporains. Laudato Si’ a inspiré de nombreuses écoles, universités et institutions — religieuses ou non — à développer des programmes sur l’écologie intégrale, l’engagement social et la justice environnementale. Des mouvements comme GreenFaith ou Young Catholic Climate Movement ont vu le jour, encourageant les jeunes générations à prendre des actions concrètes pour la justice climatique.
Le terreau d’une approche œcuménique de l’écologie
Laudato Si’ a marqué une étape importante dans les relations œcuméniques, entrant en profonde résonnance avec les préoccupations partagées par de nombreuses Églises chrétiennes à travers le monde. L’encyclique a ainsi pu être perçue comme un appel unifiant, invitant les chrétiens à se rassembler pour faire face à la crise écologique.
L’approfondissement du dialogue entre l’Église catholique et les Églises de tradition orthodoxe et orientale est le plus notable. L’intérêt de longue date des communautés monastiques orthodoxes pour une vie au plus proche de la nature destinaient ces Eglises à une lecture favorable du texte. Ainsi, le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier, souvent appelé le “pape vert” en raison de ses préoccupations écologiques de la première heure, a exprimé son soutien, soulignant que la défense de la nature est une “responsabilité morale” pour les chrétiens de toutes traditions. Il a salué Laudato Si’ comme une contribution significative au dialogue inter-chrétien et à l’engagement commun pour la sauvegarde de l’environnement.
Les membres des Eglises protestantes ont aussi accueilli favorablement l’encyclique. En France, l’initiative « Eglise verte » a représenté un catalyseur de cette conversion.
Lire aussi : Regard protestant sur Laudato Si’
Le texte du pape a également renforcé les relations avec l’Église anglicane, l’archevêque de Cantorbéry Justin Welby louant Laudato Si’ pour sa manière de relier de manière concrète les enjeux écologiques à la dignité humaine et à la solidarité entre les peuples. Ce dialogue a été essentiel dans l’établissement d’une coopération chrétienne mondiale.
Un appel rejoignant les préoccupations des différentes religions
L’encyclique a aussi jeté les bases d’un dialogue interreligieux sur l’écologie, fondé sur une conscience partagée de la responsabilité humaine envers la Terre et les générations futures. De nombreuses traditions spirituelles ont reconnu dans ce texte une convergence avec leurs propres enseignements sur le respect de la nature, ouvrant la voie à des collaborations inédites entre confessions dans la lutte contre la dégradation environnementale.
Dans le monde musulman, Laudato Si’ a été saluée pour sa préoccupation commune avec les enseignements du Coran sur la protection de l’environnement, tel que repris dans l’initiative fédératrice d’« Al Mizan » (« équilibre »). Dans la tradition islamique, la Terre est considérée comme un bien sacré, un amana (dépôt confié par Dieu), et les croyants sont invités à en prendre soin. Le Grand Mufti d’Égypte, Ahmed el-Tayeb, a exprimé son soutien à l’appel du pape François. Le dialogue s’est approfondi avec des discussions sur la manière de mettre en œuvre concrètement les principes (par exemple à travers des campagnes de reforestation et de sensibilisation à l’impact du changement climatique).
Le judaïsme, avec sa tradition de préservation de la Terre dans le cadre de l’alliance divine (concept de Tikkun Olam), a aussi répondu positivement, notant que l’encyclique s’aligne avec les principes juifs de justice sociale et de respect envers la nature. En 2016, des rabbins du monde entier ont exprimé leur soutien à Laudato Si’, s’engageant à travailler avec les catholiques et d’autres religions sur des initiatives environnementales. Le Rabbinat a encouragé ses membres à intégrer les principes de durabilité et de respect de la nature dans leur mode de vie.
Une résonnance au-delà des religions monothéistes
Les leaders hindous et bouddhistes, qui considèrent la nature comme sacrée et fondamentalement interconnectée avec l’humain, ont vu dans l’encyclique un appel à l’action pour une plus grande solidarité interreligieuse. Des organisations hindoues et bouddhistes ont adopté Laudato Si’ comme un texte de référence dans leurs discussions sur la spiritualité et la protection de l’environnement. Le Dalaï Lama a salué le pape François pour sa capacité à lier les questions environnementales à des préoccupations plus larges de justice sociale et exprimé son soutien.
Les grandes conférences interreligieuses sur l’écologie, comme celles organisées par le World Religions Summit ou par des institutions comme le Pontifical Council for Interreligious Dialogue, ont ainsi vu la participation active de leaders religieux du monde entier.
En faisant de l’écologie une question morale, spirituelle et éthique dépassant les frontières confessionnelles et culturelles, Laudato Si’ a ouvert de nouvelles voies de dialogue et de coopération par toute la planète. Dix ans après sa publication, elle reste une référence vivante.