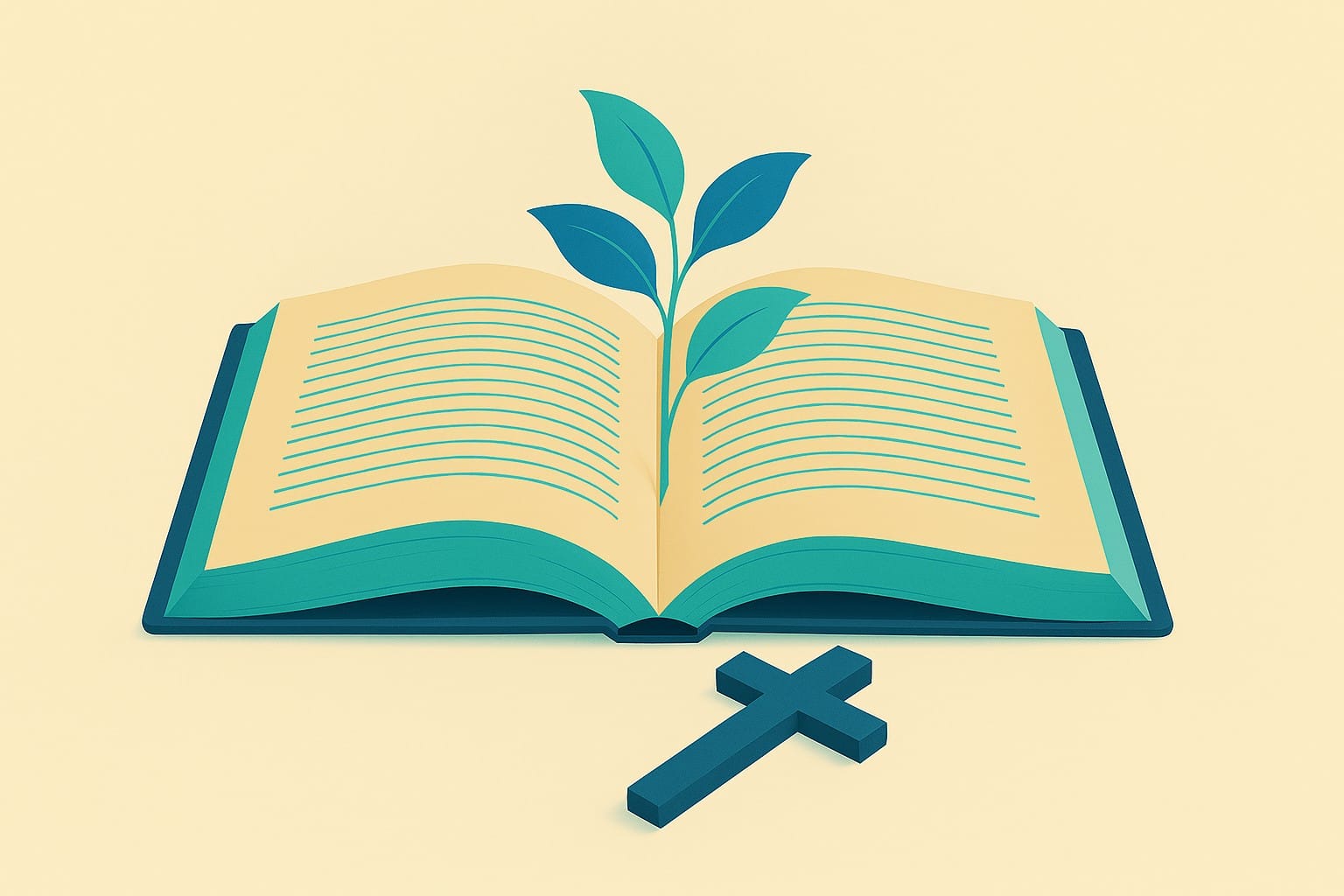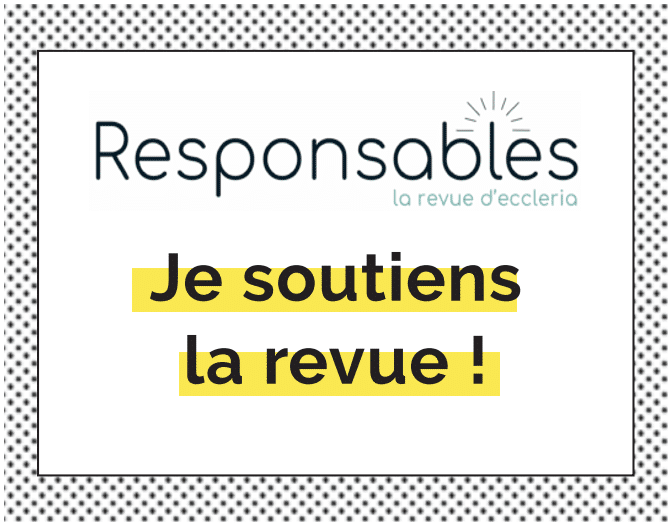Carole Thiry-Bour
Docteur en sociologie, présidente fondatrice de Reliance & Conseil.

Carole Thiry-Bour
Docteur en sociologie, présidente fondatrice de Reliance & Conseil.
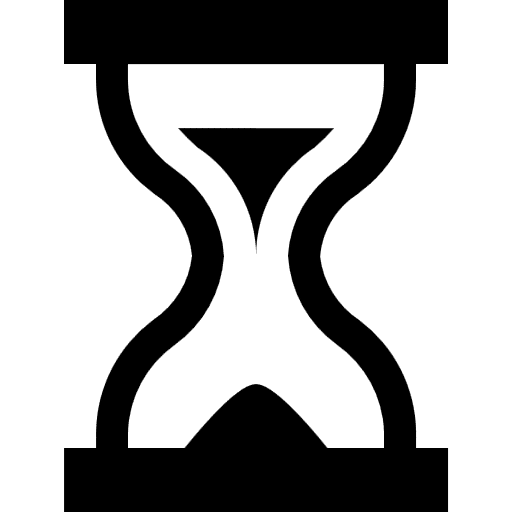
analyse
Quelles compétences pour agir avec espérance au travail
Retour sur l’intervention de Carole Thiry-Bour, docteure en sociologie, lors la rencontre annuelle des Semaines sociales de France de 2024.
Quelles sont les compétences clefs pour agir avec espérance au travail dans un contexte marqué par l’incertitude ? À notre époque, l’incertitude semble bien être la seule certitude. Nous vivons dans un monde qui se transforme rapidement (les technologies, le climat, la géopolitique, la santé, la biodiversité). Le monde du travail n’échappe pas à ce processus d’exploitation et de maîtrise, rimant avec l’accélération. Face à cette réalité galopante – suspendue pendant la crise sanitaire nous rappelant les vertus de la lenteur – comment nourrir l’espérance et œuvrer au bien commun ?
Le monde n’a jamais été aussi imprévisible
Selon Edgar Morin, l’incertitude est inhérente à la complexité du monde contemporain. Il écrit dans son livre La Méthode que « l’incertitude n’est pas accidentelle » : elle est « une composante fondamentale de la réalité » (Morin, 2008). Cette compréhension est essentielle, car elle oblige à aborder l’incertitude comme un élément intégral de notre existence, donc à apprendre à composer avec.
Le monde n’a jamais été aussi imprévisible. Soixante-seize pays sondés entre 1981 et 2021 indiquent que les convergences de valeurs mondiales ont laissé place en 40 ans à des divergences conduisant à des intérêts antagonistes. Ces écarts autour de valeurs conduisent à une nouvelle forme de conflictualité (fractures autour des identités). Ces divergences sont exacerbées par la mondialisation, qui met ces cultures en contact plus direct.
Le monde du travail est lui aussi traversé par d’importantes mutations. Au cours de ces dernières années, notre rapport au travail a connu des évolutions significatives, influencées par des facteurs tels que la pandémie, les avancées technologiques, les changements sociétaux. Citons les principales évolutions, documentées par des travaux de recherche en sciences sociales :
- L’adoption massive du télétravail : elle s’assortit de modifications des attentes des employés envers leurs employeurs (flexibilité, aménagements, moindre subordination).
- La redéfinition des priorités et de la qualité de vie : elle déplace les éléments motivationnels. Les études mettent l’accent croissant sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qui interrogent directement la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT inscrite dans le Code du travail). Le phénomène de démission douce (quiet quitting), où les employés se limitent au minimum, illustre un désengagement lorsque le travail manque de sens et ne comble pas les attentes. La motivation ne viendrait plus uniquement du statut, de la rémunération, mais de la relation avec un leader inspirant, de la mission de l’entreprise.
- L’accélération de la digitalisation et de l’automatisation : les tâches répétitives sont de plus en plus prises en charge par des machines, réservant aux travailleurs des activités nécessitant des compétences relationnelles (empathie), analytiques (sens critique) et créatives (résolution de problèmes complexes), donc non routinières et mobilisant les aptitudes socio-comportementales (savoir-être) sur lesquelles nous reviendrons.
- Les changements dans les dynamiques de pouvoir au travail : les structures hiérarchiques traditionnelles, verticales, sont remises en question en faveur de plus d’horizontalité, les travailleurs recherchant davantage d’autonomie et de reconnaissance. Les évolutions sont profondes au sein du monde professionnel. Elles se traduisent par des attentes nouvelles.
Le travail « ne saurait être détaché du reste de la vie »
En quoi ces évolutions nous renseignent-elles sur la fonction sociale du travail ? Pour Karl Polanyi, anthropologue et économiste, le travail « ne saurait être détaché du reste de la vie » (1944). Les cinq fonctions du travail sont : la structuration du temps ; un réseau social d’appartenance ; le développement des compétences ; la flexibilité psychique ; l’utilité sociale qui vient nourrir notre identité, fondement de la reconnaissance.
Le travail ne se résume donc pas à une dimension rétributive, pas plus qu’il ne se résume à une dimension formelle (le contrat de travail, la fiche de poste, l’organigramme). Le travail nous renvoie à notre utilité, à une dimension existentialiste. Or, nous vivons dans un monde de transformations perpétuelles, de « sociétés liquides » — selon l’expression de Zygmunt Bauman — où « l’agir, constamment changeant (réorganisations, fusions, rachats, turnover guidés par des motifs économiques, etc.) ne s’ancre plus sur des structures solides, telles que l’entraide, la solidarité, la cohésion », qui viennent confirmer notre existence […].
Le cycle du don : donner, recevoir, rendre
Marcel Mauss, anthropologue français, a introduit l’idée fondamentale que le cycle du “donner-recevoir-rendre en retour” constitue le « roc de l’humanité », c’est-à-dire une base essentielle des relations humaines et de la société (Essai sur le don, 1925). Ce cycle fonde l’alliance, pacifie les relations.
- Donner : quelqu’un offre quelque chose à une autre personne, que ce soit un objet,
un service ou un geste d’amitié. - Recevoir : la personne qui reçoit le geste, l’attention, le service, l’accepte avec gratitude. Cela crée une obligation morale chez le receveur qui reconnaît l’acte de générosité
- Rendre en retour : à un moment donné, non défini dans le temps, le receveur se sentira obligé de rendre la faveur. Cela ne signifie pas qu’il rendra exactement le même objet ou service, mais il répondra d’une manière qui montre qu’il apprécie et reconnaît le don initial.
Ce cycle exclut toute forme de calcul et se perpétue à la faveur d’un temps long. Or, les mobilités professionnelles à visée carriériste ne favorisent pas cet ancrage. Ce cycle possède quatre effets vertueux qui peuvent nourrir notre existence et fonder notre reconnaissance :
- Créer des liens sociaux : en donnant, nous montrons que nous nous soucions de l’autre ; en recevant, nous reconnaissons la valeur de l’autre ; en rendant en retour, nous solidifions le lien en montrant notre gratitude.
- Favoriser la coopération par un réseau de soutien mutuel et de réciprocité.
- Construire la confiance et la réputation
- Instaurer un sens de communauté en donnant à chacun un sentiment d’appartenance
Le cycle du don est donc une composante essentielle de la vie sociale en ce qu’il contribue à pérenniser les relations. Il se pourrait bien que l’espérance réside au cœur des compétences socio-comportementales
Le cycle du don est donc une composante essentielle de la vie sociale en ce qu’il contribue à pérenniser les relations. Il est au cœur de la manière dont nous interagissons, construisons des relations et maintenons la cohésion sociale. Ce cycle nourrit notre existence en créant des liens, en favorisant la coopération, en construisant la confiance et en instaurant un sens profond de reconnaissance : en résumé, tout ce que l’on espère du travail. Il se pourrait bien que l’espérance réside au cœur des compétences socio-comportementales (soft skills).
L’intelligence émotionnelle, aptitude socle pour agir avec espérance
Les soft skills sont des aptitudes comportementales qui influencent la manière dont nous interagissons avec les autres. Dans un monde du travail soumis à des changements rapides avec une péremption accrue (savoirs techniques), ces compétences sont essentielles. Minouche Shafik, ancienne directrice de la London School of Economics, nous dit :
Hier nos emplois se concentraient sur les muscles, aujourd’hui sur les cerveaux, demain ils devront faire la part belle à nos cœurs.
« L’intelligence émotionnelle correspond à la capacité de traiter des informations sur ses propres émotions et celles des autres. En outre, cela inclut également la possibilité d’utiliser cette information comme guide de réflexion et de comportement. Ainsi, les personnes ayant une intelligence émotionnelle développée font attention, utilisent, comprennent, [ndr : apprivoisent] les émotions. D’autre part, ces compétences servent à des fonctions adaptatives qui leur procurent des avantages, à eux-mêmes et à d’autres. » (Peter Salovey, John Mayer, 1990). De cette capacité, découlent :
- La résilience, cette capacité à rebondir après des échecs ou des situations difficiles. Elle est fondamentale pour naviguer dans un environnement incertain. Selon une étude publiée dans le Harvard Business Review, les employés résilients sont capables de s’adapter rapidement aux changements et de maintenir un niveau élevé de performance malgré les obstacles (Coutu, 2002).
- L’adaptabilité, qui consiste à ajuster ses comportements et ses stratégies en réponse à des changements imprévus. Elle est particulièrement importante dans un contexte où les conditions de travail évoluent rapidement. Favoriser l’apprentissage continu. Former les collaborateurs, les faire monter en compétence. Ecouter et répondre aux attentes des salariés.
- L’assertivité : une communication claire, précise, factuelle, sans jugement est essentielle pour gérer l’incertitude. Parler à la première personne, identifier ses émotions et connaître ses besoins aide à s’exprimer sans agressivité ni soumission. Un rapport du Project Management Institute souligne que les projets avec une communication efficace sont 50 % plus susceptibles d’être achevés avec succès (PMI, 2013).
- Un leadership inspirant : les leaders jouent un rôle crucial en période d’incertitude. Un leadership inspirant est capable de mobiliser les équipes, de donner du sens et de l’orientation. Simon Sinek (2009) affirme que les leaders qui communiquent une vision claire et motivante peuvent inspirer l’engagement et la confiance.
Le travail ne se résume pas à des éléments contractuels et chiffrés. Henry Ford disait : « Deux éléments n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses hommes. » Les aptitudes interpersonnelles sont indispensables pour évoluer dans un monde du travail en perpétuelle mutation. Elles sont autant des solutions de pacification des relations, car elles permettent de dépasser les aspects individuels et de se décentrer – le fameux pas de côté.
Des approches multidimensionnelles pour cultiver l’espérance
Toutes les approches dites systémiques, car elles sont multidimensionnelles, comme l’approche contextuelle (prenant en compte les faits, la dimension psychologique, transactionnelle, l’éthique relationnelle), les régulations d’équipe, l’analyse des pratiques professionnelles sont particulièrement bénéfiques car elles permettent de travailler sur le cadre, les postures, l’éthique relationnelle.
Les pratiques qui réintroduisent des espaces de narration salvateurs, en grande partie perdus car remplacés par la dématérialisation, sont particulièrement bénéfiques.
Ces pratiques réintroduisent des espaces de narration salvateurs, en grande partie perdus, car remplacés par la dématérialisation (la transmission informatique des données se fait au détriment du partage d’expérience, du récit, du ressenti) ou encore négligés par manque de temps ; le co-développement, l’intelligence collective ; toutes ces approches qui favorisent la co-construction et le sentiment de reconnaissance.
En bref, pour agir avec espérance dans un contexte marqué par l’incertitude, il est essentiel de développer et de cultiver des compétences interpersonnelles telles que la résilience, l’adaptabilité, la communication, le leadership inspirant. Il est fondamental de créer un environnement de travail favorisant la collaboration, la prise en compte d’autrui. Le cycle du don est une puissante référence et une inestimable source d’espérance.