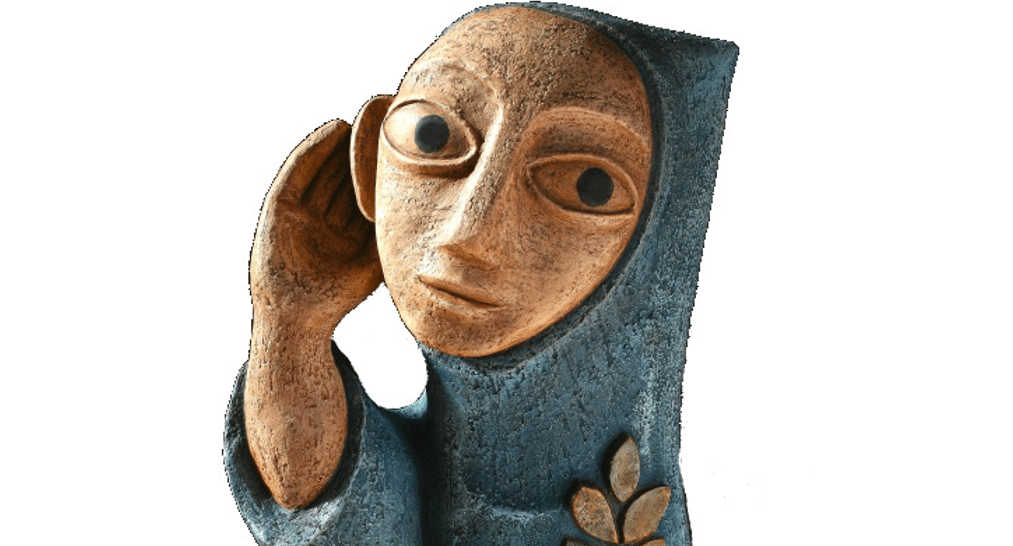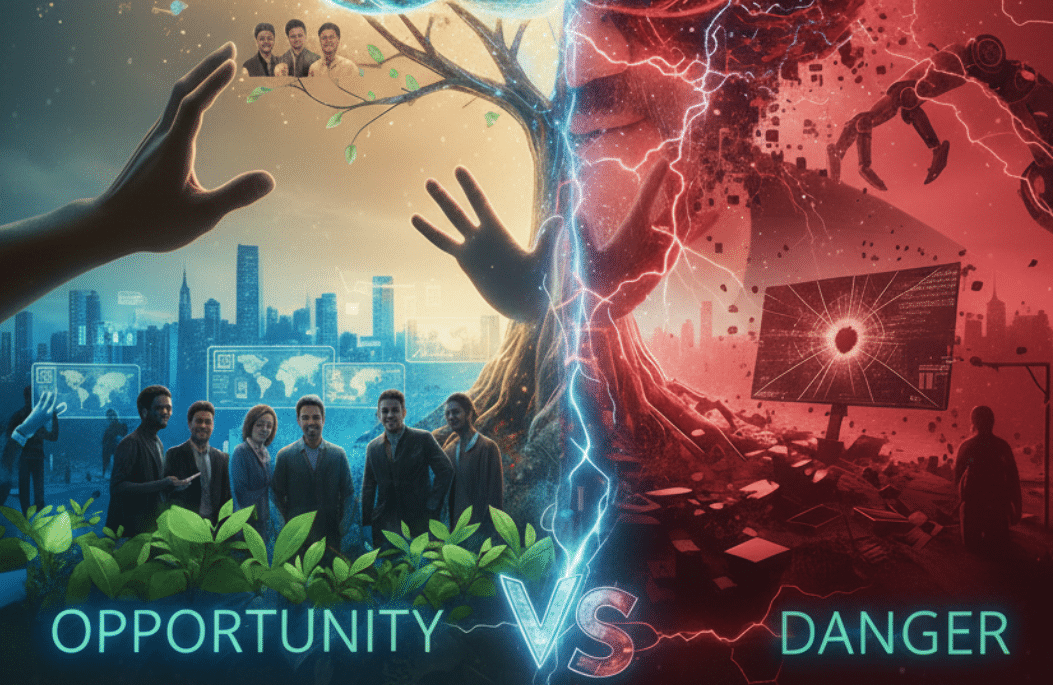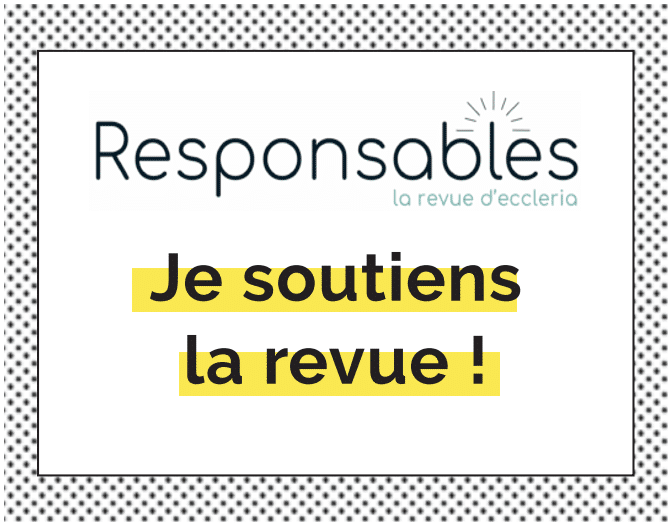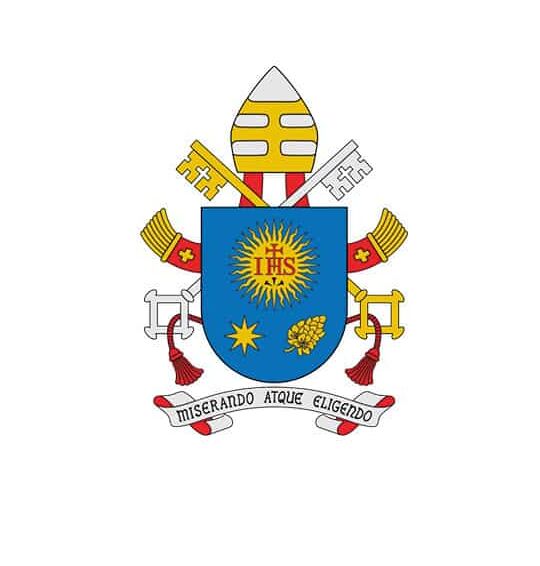
Dicastère pour la doctrine de la foi
Dicastère pour la culture et l’éducation
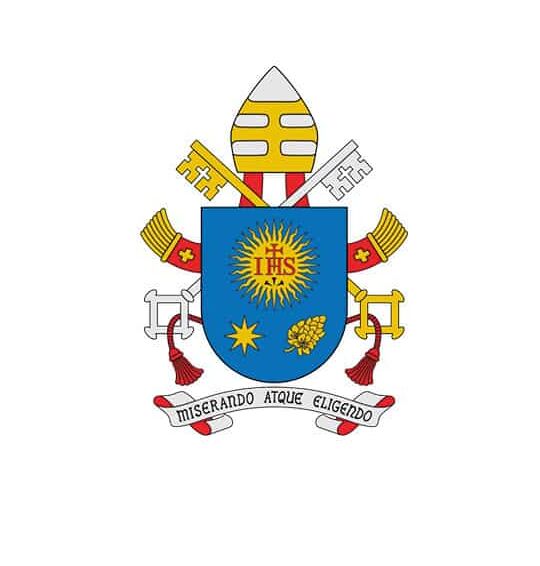
Dicastère pour la doctrine de la foi
Dicastère pour la culture et l’éducation
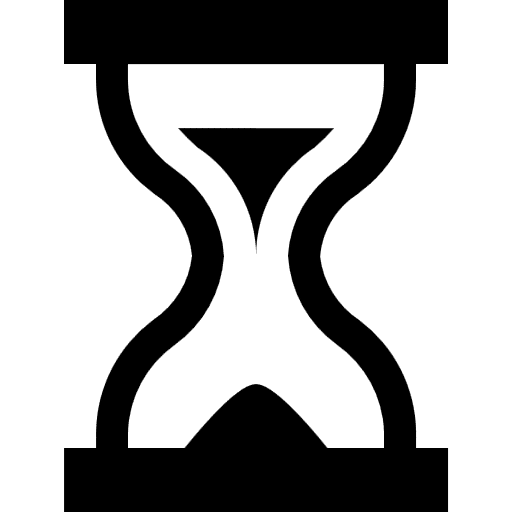
ressource
Antiqua et Nova
Note sur les relations entre l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine
Publié le 28 janvier 2025, le document Antiqua et Nova, traite des enjeux anthropologiques, éthiques et sociaux liés à l’intelligence artificielle. Extrait des passages relatifs au monde professionnels.
IA, économie et travail
- Compte tenu de sa nature transversale, l’IA est également de plus en plus appliquée dans les systèmes économiques et financiers. Actuellement, les investissements les plus prononcés sont observés dans le secteur technologique ainsi que dans ceux de l’énergie, de la finance et des médias, avec une référence particulière aux domaines du marketing et des ventes, de la logistique, de l’innovation technologique, de la conformité et de la gestion des risques. L’application à ces domaines révèle la nature ambivalente de l’IA, source d’énormes opportunités mais aussi de risques profonds. Une première criticité réelle découle de la possibilité que, du fait de la concentration de l’offre en quelques entreprises, ce soient ces dernières qui bénéficient de la valeur créée par l’IA plutôt que les entreprises dans lesquelles elle est utilisée.
- Par ailleurs, dans la sphère économico-financière, il existe des aspects plus généraux sur lesquels l’IA peut produire des effets qu’il convient d’évaluer avec soin, liés avant tout à l’interaction entre la réalité concrète et le monde numérique. Un premier point à considérer concerne la coexistence d’institutions économiques et financières qui se présentent dans un contexte donné sous des formes différentes et alternatives. Il s’agit d’un facteur à promouvoir car il pourrait apporter des avantages en termes de soutien à l’économie réelle en favorisant son développement et sa stabilité, en particulier en temps de crise. Toutefois, il convient de souligner que les réalités numériques, libérées des contraintes spatiales, tendent à être plus homogènes et impersonnelles qu’une communauté liée à un lieu particulier et à une histoire concrète, avec un parcours commun caractérisé par des valeurs et des espoirs partagés, mais aussi par d’inévitables désaccords et divergences. Cette diversité est un atout indéniable pour la vie économique d’une communauté. Remettre l’économie et la finance entièrement entre les mains de la technologie numérique réduirait cette variété et cette richesse, de sorte que de nombreuses solutions aux problèmes économiques, accessibles par un dialogue naturel entre les parties concernées, risquent de ne plus être viables dans un monde dominé par des procédures et des proximités qui ne sont qu’apparentes.
- Le monde du travail est un autre domaine où l’impact de l’IA se fait déjà profondément sentir. Comme dans beaucoup d’autres domaines, elle provoque des transformations substantielles dans de nombreuses professions, avec des effets divers. D’une part, l’IA a le potentiel d’accroître les compétences et la productivité, offrant la possibilité de créer des emplois, permettant aux travailleurs de se concentrer sur des tâches plus innovantes et ouvrant de nouveaux horizons à la créativité et à l’inventivité.
- Cependant, alors que l’IA promet de stimuler la productivité en prenant en charge des tâches ordinaires, les travailleurs sont souvent contraints de s’adapter à la vitesse et aux exigences des machines, au lieu que ces dernières soient conçues pour aider ceux qui travaillent. Ainsi, contrairement aux avantages annoncés de l’IA, les approches actuelles de la technologie peuvent paradoxalement déqualifier les travailleurs, les soumettre à une surveillance automatisée et les reléguer à des tâches rigides et répétitives. La nécessité de suivre le rythme de la technologie peut éroder le sentiment d’autonomie des travailleurs et étouffer les compétences innovantes qu’ils sont appelés à apporter à leur travail [125].
- L’IA supprime la nécessité de certaines activités précédemment exercées par les humains. Si elle est utilisée pour remplacer les travailleurs humains plutôt que pour les accompagner, il existe un « risque substantiel d’avantage disproportionné pour quelques-uns au détriment de l’appauvrissement du plus grand nombre » [126]. En outre, à mesure que l’IA devient plus puissante, le travail risque de perdre sa valeur dans le système économique. C’est la conséquence logique du paradigme technocratique : le monde d’une humanité asservie à l’efficacité, dans lequel, en fin de compte, le coût de cette humanité doit être réduit. Au contraire, les vies humaines sont précieuses en elles-mêmes, au-delà de leur rendement économique. Le Pape François coûte que, en conséquence de ce paradigme, aujourd’hui « il ne semble pas logique d’investir pour que les laissés-pour-compte, les faibles ou les moins doués puissent faire leur chemin dans la vie » [127]. Et nous devons conclure avec lui que « nous ne pouvons pas permettre qu’un outil aussi puissant et indispensable que l’intelligence artificielle renforce un tel paradigme, mais nous devons plutôt faire de l’intelligence artificielle un rempart précisément contre son expansion » [128].
- C’est pourquoi il est bon de toujours se rappeler que « dans l’ordre des choses, il faut se conformer à l’ordre des personnes et non l’inverse » [129]. Le travail humain ne doit donc pas être seulement au service du profit, mais « de l’homme : de l’homme considéré dans sa totalité, c’est-à-dire en tenant compte de la hiérarchie de ses besoins matériels et des exigences de sa vie intellectuelle, morale, spirituelle et religieuse » [130]. Dans ce contexte, l’Église reconnaît que le travail n’est « pas seulement […] une façon de gagner son pain », mais aussi « une dimension inaliénable de la vie sociale » et « un moyen de croissance personnelle, d’établir des relations saines, de s’exprimer, de partager des dons, de se sentir coresponsable de l’amélioration du monde et, en fin de compte, de vivre en tant que peuple » [131].
- Étant donné que le travail « fait partie du sens de la vie sur cette terre, un chemin vers la maturité, le développement humain et l’épanouissement personnel », « nous ne devrions pas chercher à remplacer de plus en plus le travail humain par le progrès technologique : cela nuirait à l’humanité elle-même » [132], mais plutôt nous efforcer de le promouvoir. Dans cette perspective, l’IA devrait assister et non remplacer le jugement humain, tout comme elle ne devrait jamais dégrader la créativité ou réduire les travailleurs à de simples « rouages de la machine ». Par conséquent, « le respect de la dignité des travailleurs et l’importance de l’emploi pour le bien-être économique des individus, des familles et des sociétés, la sécurité de l’emploi et des salaires équitables, devraient être une priorité absolue pour la communauté internationale à mesure que ces formes de technologie pénètrent de plus en plus profondément sur le lieu de travail » [133].
La vraie sagesse
- Aujourd’hui, l’immense étendue des connaissances est accessible d’une manière qui aurait émerveillé les générations passées ; cependant, pour éviter que le progrès de la science ne reste humainement et spirituellement stérile, il faut aller au-delà de la simple accumulation de données et viser la vraie sagesse [208].
- Cette sagesse est le don dont l’humanité a le plus besoin pour faire face aux questions profondes et aux défis éthiques posés par l’IA : « Ce n’est qu’en nous dotant d’un regard spirituel, qu’en retrouvant une sagesse du cœur, que nous pourrons lire et interpréter la nouveauté de notre temps » [209]. Cette « sagesse du cœur » est « cette vertu qui nous permet de tisser ensemble le tout et les parties, les décisions et leurs conséquences ». L’humanité ne peut pas « exiger cette sagesse des machines », car elle « se laisse trouver par ceux qui la cherchent et se laisse voir par ceux qui l’aiment ; elle devance ceux qui la désirent et va à la recherche de ceux qui en sont dignes (cf. Sg 6, 12–16) » [210].
- Dans un monde marqué par l’EI, nous avons besoin de la grâce de l’Esprit Saint, qui « nous permet de voir les choses avec les yeux de Dieu, de comprendre les liens, les situations, les événements et d’en découvrir le sens » [211].
- Puisque « ce qui mesure la perfection des personnes, c’est leur degré de charité, et non la quantité de données et de connaissances qu’elles peuvent accumuler » [212], la manière dont l’intelligence artificielle est adoptée « pour inclure les derniers, c’est-à-dire les frères et les sœurs les plus faibles et les plus nécessiteux, est la mesure révélatrice de notre humanité » [213]. Cette sagesse peut éclairer et guider une utilisation centrée sur l’homme de cette technologie qui, en tant que telle, peut aider à promouvoir le bien commun, à prendre soin de la « maison commune », à faire progresser la recherche de la vérité, à soutenir le développement humain intégral, à encourager la solidarité et la fraternité humaines et à conduire l’humanité à son but ultime : la communion heureuse et pleine avec Dieu [214].
- Dans la perspective de la Sagesse, les croyants pourront agir comme des agents responsables, capables d’utiliser cette technologie pour promouvoir une vision authentique de la personne humaine et de la société [215], à partir d’une compréhension du progrès technologique comme faisant partie du plan de Dieu sur la création : une activité que l’humanité est appelée à ordonner au Mystère pascal de Jésus-Christ, dans la recherche constante du Vrai et du Bien.